Découvrez l'histoire du Rwanda
- Miss.VINCI

- 26 mai 2020
- 11 min de lecture
Le Rwanda existait bien avant la colonisation européenne. Elle avait son organisation politique et socio-économique, sa culture et ses coutumes, et elle était une nation souveraine. Le Rwanda était un ancien royaume avec trois groupes sociaux qui, plus tard, à l’époque coloniale, sont devenus connus sous le nom d’ethnie : les Tutsi, les Hutu et les Twa. Twa étaient les habitants indigènes de la région et étaient connus pour leur chasse et leur artisanat.

LE RWANDA

Capitale : Kigali Langues officielles : anglais, français, kinyarwanda, kiswahili Monnaie : Franc rwandais Population : 12,2 millions d’habitants (2017)
Le Rwanda est un pays enclavé situé dans la partie centrale de l’Afrique. Les gens ont commencé à s’installer dans la région au cours du 10ème millénaire avant J.C. En 600 avant J.C, les habitants de la région savaient travailler le fer, avaient une petite quantité de bétail et plantaient de petites quantités de sorgho et de mille.
Après plusieurs vagues successives de migrations, le Rwanda a vu la formation de plusieurs royaumes plus petits dans les années 1100; et vers les années 1500; C'est ainsi qu'un royaume plus grand et plus centralisé connu sous le nom de Royaume du Rwanda a émergé. Le royaume du Rwanda a été gouverné par les Mwami (King), et le royaume a atteint le sommet de son expansion territoriale à la fin des années 1800.

Les premiers habitants du Rwanda étaient les Batwa. Les Batwas continuent de vivre comme chasseurs/cueilleurs dans le nord du pays, mais représentent moins de 1 % de la population totale, il s'agit d'un peuple pygmées. Vers le début du 14eme siècle, les paysans Bahutu, appartenant au groupe bantu, sont venus au pays et ont imposé leur langue et leurs coutumes aux habitants indigènes. Les "Hutus" formaient la majorité de la population et étaient associés à l’exploitation des terres. Ils ont mis en place un système socio-économique basé sur l’agriculture à petite échelle et les petits pâturages appelés bahinza. Leur lien avec le sol est amplement illustré par le fait que bahinza signifie « ceux qui font pousser les choses », ce qui illustre les liens étroits entre la politique et l’agriculture. Il s’agissait d’agriculteurs à petite échelle dont la structure sociale était fondée sur le clan. Les rois, ou Bahinza, régnaient sur des groupes claniques limités. Les Hutus croyaient que le Bahinza pouvait faire appel à la pluie et protéger les cultures contre les insectes et la mort du bétail. Les Bahinza tirent leur pouvoir et leur statut de cette croyance.

Les Batutsi, descendants d’un peuple d’éleveurs, sont arrivés du nord aux 15eme et 16eme siècles, dernière vague de migrants qui fuyaient la famine et la sécheresse (d’Afrique centrale ou orientale) et ont établi une domination politique traditionnelle dans la région fondée sur la monarchie. Il ne s’agissait pas d’une invasion soudaine, mais d’un processus lent et essentiellement pacifique. Les "Tutsis" possédaient les bétails et étaient considérés comme des riches ou issus des classes supérieures. Sous la règle tutsi, la propriété des terres était la prérogative exclusive du roi tutsi, le Mwami. Les Tutsis ont utilisé leur connaissances du bétail et leurs compétences au combat avancées pour exercer un contrôle économique, politique et social sur les Hutus. Certains chercheurs ont trouvé des liens entre les Tutsis et les Maasi et les Oromo d’Éthiopie, les descendants de "Ham" Cham ( fils de Noé,), et même des anciens Égyptiens. Les trois groupes ethniques dominants étaient profondément intégrés au point qu’il aurait été difficile de les distinguer. Les groupes avaient une langue commune, beaucoup de même pratiques culturelles et croyaient à la même religion. C’est surtout grâce à leurs moyens de production, l’élevage bovin (Tutsi), l’agriculture (Hutu) et chasseur / cueillette (Twa) que des distinctions ont été faites.
La relation entre les Tutsis et les Hutus s’est transformée en un contrat patron-client connu sous le nom d’ubuhake, un accord inégal par lequel les Hutus ont obtenu l’utilisation du bétail Tutsi et de leurs produits en échange de travail et de service militaire. Le pouvoir des Mwami a été renforcé par un mythe d’origine divine. Finalement, la propriété foncière a été retirée aux Hutus et est devenue la propriété du roi Tutsi, ou Mwami. Au début, l’accord signifiait que les Hutus pouvaient utiliser du bétail tutsi en échange du service personnel et militaire. Avec le temps ubuhake est devenu un système de classe de type féodal par lequel la terre et le bétail, et donc le pouvoir, étaient entre les mains de la minorité tutsie. Les Hutus se sont liés à un seigneur tutsi en lui donnant des produits agricoles et des services personnels en échange de l’utilisation de la terre et du bétail. La structure du système monarchique tutsi a été mise en place dans les années 1800, composé d’une hiérarchie de chefs et de sous-chefs avec le Mwami au sommet de la pyramide. L’unité la plus basse était l’umusozi ou colline. L’Hima, une petite tribu de nomades nilotiques, continue de gagner sa vie en voyageant dans les parties nord et nord-est du Rwanda.
Le Mwami était considéré comme d’origine divine.Un mythe raconte que trois enfants nés au ciel sont tombés sur terre par accident, et que l’un d’eux, Kigwa, a fondé le plus puissant clan tutsi. Les Mwami sont issus de ce divin fondateur. Au milieu du 16eme siècle, Mwami Mibambwe I Mutabazi a pu centraliser la monarchie et réduire le pouvoir des chefs voisins. Au début du 19e siècle, Mwami Kigeri IV a établi les frontières qui étaient en place lorsque les Allemands sont arrivés en 1894.

Le Rwanda a son origine dans un royaume qui a été fondé au 17eme siècle et a été dominé par la dynastie Nyiginya jusqu’au coup d’État de 1896 qui a brisé le pouvoir des lignées aristocratiques Nyiginya. Alors que quelques divisions internes ont émergé parmi les membres de la maison royale en 1896, la dynastie d’Abanyiginya également connue sous le nom de dynastie Nyiginya, a régné depuis sa fondation jusqu’à ce que le pays devienne la République du Rwanda au début des années 1960.
Plusieurs explorateurs européens se sont approchés du Rwanda au 19e siècle, mais aucun n’a pénétré au Rwanda. En 1855, Richard Burton et John Hanning Speke passèrent près du Rwanda à la recherche de la source du Nil .Henry Morton Stanley, en 1876, est également venu dans cette région, mais n’est pas allé au Rwanda. La Conférence de Berlin de 1885 déclara que la région qui deviendra plus tard le Rwanda et le Burundi sera sous influence et contrôle allemands.Ce fut 9 ans après cette conférence que le premier Européen se rendit au Rwanda.C’était le comte allemand Von Götzen qui devint plus tard le gouverneur de l’Afrique de l’Est allemande.
Le Rwanda et le Burundi étaient situés à la jonction de trois empires et sont devenus l’objet d’une lutte diplomatique pour leur possession. Les Belges avec Léopold II, les Allemands et les Britanniques voulaient posséder le territoire. Cependant, en 1910, un accord a remis le contrôle du Rwanda et du Burundi aux Allemands. Les Allemands ont gouverné indirectement à travers la structure politique créée par les Mwami. Les Allemands ont également mené des opérations militaires contre des chefs hutus dans le Nord qui n’étaient pas sous le contrôle des Mwami. Dans les années 1920 et 1930, les Allemands ont organisé de vastes plantations de café; et ont commencé à percevoir la taxe, non pas sur les productions agricoles mais dans le but de forcer la plantation de café. À son époque, les premiers missionnaires arrivèrent aussi au Rwanda. Les Pères blancs fondèrent des missions et des écoles dès 1903.
Pendant la Première Guerre mondiale, les Belges ont pris le contrôle du Rwanda et du Burundi. Après la guerre, le 23 août 1923, la Société des Nations a mandaté le Rwanda et le Burundi sous la supervision belge. Le pouvoir des Mwami a été réduit. Ils ont modifié le système ubuhake et ont éliminé le paiement des tributs. Les Belges ont conservé la tutelle mais ont dû intégrer les Rwandais dans le processus politique. Cela a conduit à une représentation politique limitée au sein du gouvernement. En 1952, la Belgique a mis en œuvre le Plan décennal de développement, une série de vastes réformes socio-économiques visant à promouvoir le progrès politique et la stabilité sociale; toutefois, ce programme a par la suite accordé à la minorité la domination économique et sociale sur la majorité hutu. En 1959, après sept années de troubles civils croissants entre les Hutus et les Tutsis, les administrateurs belges ont déclaré l’état d’urgence et ont appelé les forces terrestres et les parachutistes en provenance du Congo pour rétablir l’ordre. La même année, les administrateurs ont demandé l’élection de nouveaux conseils communaux dans l’espoir de dissiper le déséquilibre du pouvoir tutsi. À la suite de l’élection prématurée de 1960, les autorités belges ont de facto reconnu l’État républicain rwandais afin d’éviter davantage de troubles sociaux.
La Belgique, selon l’Assemblée générale des Nations Unies, était toujours responsable de l’exécution de son accord de tutelle et a été invitée à superviser les élections pour assurer la mise en place d'un gouvernements de transition stables au Burundi et au Rwanda. Cependant, en avril 1962, les deux pays ont décidé qu’une union politique était impossible en raison de l’antagonisme historique de longue date entre leurs deux républiques. Quelques jours plus tard, le Rwanda a accédé à l’indépendance.

En 1962, le Rwanda est devenu indépendant, avec Gregoire Kayibanda, chef de PARMEHUTU, comme président. Une nouvelle constitution a été ratifiée. Peu après, en 1963, les Tutsis ont envahi le Rwanda mais ont été repoussés. En représailles, plus de 12 000 Tutsis ont été massacrés par les Hutus, tandis que d’innombrables Tutsis ont fui le pays. L’année suivante, l’union économique du Rwanda et du Burundi a pris fin; le Rwanda a introduit sa propre unité monétaire nationale, le franc rwandais. En 1969, Kayibanda a été réélu pour un deuxième mandat de quatre ans. La présidence de Kayibanda a pris fin en 1973 lorsqu’il a été renversé par un coup d’État sans sang dirigé par le major général Juvenal Habyarimana. Lors de la Conférence de Bujumbura de 1974, le Zaïre, le Burundi et le Rwanda se sont mis d’accord sur une action concertée en matière de défense et d’affaires économiques. En 1975, Habyarimana a lancé Le Movement Revolutionaire National pour le Développement (MRND) en tant que seul parti politique du pays et il a été réélu président en 1983 et 1988.
La guerre civile a commencé en 1990 quand entre 5000 et 10000 rebelles tutsis ont envahi le Rwanda depuis l’Ouganda voisin ; Habyarimana et les rebelles ont accepté un cessez-le-feu le 29 mars 1991. En 1992, le gouvernement a signé un accord à Arusha le 14 juillet et un cessez-le-feu débutera le 31 juillet. Le 18 septembre, un document conjoint a été signé à Arusha sur un règlement politique incluant le partage du pouvoir entre les parties. Un accord sur le pouvoir présidentiel dans la période de transition proposée a été conclu le 12 octobre 1992. Après une réunion de trois jours des ministres de l’Intérieur et de la Justice du Rwanda et du Burundi, les deux parties se sont mises d’accord le 24 novembre sur plusieurs mesures, notamment le contrôle des activités des réfugiés, les actions contre le trafic d’armes, l’achèvement de la délimitation des frontières et a demandé aux médias de faire preuve de retenue. Suite aux fausses rumeurs de, Radio Rwanda qui a délibérément inventée une nouvelle selon laquelle un complot tutsi qui visait à massacrer les Hutus a été découvert.
Même si, en 1993, le gouvernement et le FPR ont signé un accord sur le partage du pouvoir à Arusha le 10 janvier, des violences ethniques ont éclaté en février, faisant des centaines de morts chez les Hutus et les Tutsis. Avec la médiation de la Tanzanie, le gouvernement et le FPR ont accepté un nouveau cessez-le-feu à partir du 9 mars; l’accord stipulait en outre le départ des troupes étrangères du Rwanda et leur remplacement par une force ONU. Une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée en juin, a établi la Mission d’observation Ouganda-Rwanda (UNOMUR). Le gouvernement rwandais et le FPR ont signé un nouvel accord de paix le 4 août à Arusha. Les espoirs de paix furent bientôt déçus, car des obstacles à la paix surgirent. Lorsque le président Juvenal Habyarimana et le président du Burundi ont été tués à leur retour de Dar es Salaam à Kigali le 6 avril 1994 par une roquette, presque certainement tirée par des extrémistes hutus, abat leur avion. Peu de temps après le crash, des meurtres organisés ont commencé à Kigali. L’assassinat du président secrètement orchestré est le prétexte immédiat de l’orgie de l’extrémisme hutu qui s’est déchaînée au cours des semaines suivantes. Les émissions de radio exhortaient les gens à faire leur devoir et à rechercher les sympathisants tutsis qui vivent parmi eux dans leurs rues ou leurs villages. De "les éliminer comme des cafards" tel était le message.
Le gouvernement a fui vers Gitarama et le FPR s’est approché de la capitale. Plus de 800 000 Rwandais ont été tuées à Kigali entre avril et juillet. Le meurtre des Tutsis s’est ensuite propagé à d’autres régions du Rwanda et a continué sans relâche pendant des semaines. À la mi-juin, le gouvernement français a annoncé que 2 500 soldats français seraient envoyés au Rwanda pour établir une « zone de sécurité » dans le sud-ouest, dans le but d’éviter d’autres décès. L’intervention française, appelée Opération Turquoise a été lancé le 22 juin. Les forces françaises ont d’abord débarqué au Zaïre, puis sont entrées au Rwanda et ont établi la « zone de sécurité» à la frontière sud-ouest du Zaïre. Le 17 juillet, le FPR a annoncé que l’un de ses dirigeants, Pasteur Bizimungu, un Hutu, avait été choisi pour être président du Rwanda. Le lendemain, le FPR déclara que la guerre était terminée. Même si le régime déchu continuait de soutenir qu’il était toujours le gouvernement légitime du Rwanda et s’engageait à renouveler la guerre, une certaine stabilité a été acquise lorsque d’autres pays ont rapidement reconnu le nouveau gouvernement.

Au début de décembre, un panel de trois juristes africains, Atsu Koffi Amega du Togo, Haby Dieng de Guinée et Salifou Fomba du Mali, a présenté à l’ONU une étude sur le meurtre desTutsis. Elle a conclu que "la plupart des preuves indiquent que l’extermination des Tutsis par les Hutus a été planifiée des mois à l’avance. Les massacres ont été perpétrés principalement par des Hutus d’une manière déterminée, planifiée, systématique et méthodique, et inspirés par la haine ethnique." Elle a également fait valoir qu’il existait "des raisons sérieuses de conclure que les Tutsis avaient également procédé à des massacres, à des exécutions sommaires, à des violations du droit international humanitaire et à des crimes contre l’humanité à l’égard des Hutus." Au début de 1995, le 7 janvier, le président Bizimungu a rencontré les présidents du Burundi, de la Tanzanie, de l’Ouganda et de la Zambie, ainsi que le premier ministre du Zaïre, pour discuter des difficultés internes du Rwanda et du problème des réfugiés.

Fin 1996, l’Alliance des Forces Démocrates pour la Libération du Congo-Zaïre (AFDL) dirigée par Laurent Kabila a démantelé les principaux camps de réfugiés rwandais au Zaïre. En mai 1997, Kabila a pris le pouvoir au Zaïre, changeant le nom du pays en République démocratique du Congo. À la fin de l’année, l’APR et les troupes angolaises sont restées au Rwanda. Le premier procès de génocide du Rwanda s’ouvre devant le Tribunal pénal international pour les personnes accusées d’avoir participé au génocide.En raison du nombre élevé de ces accusés, des tribunaux communautaires, appelés Gacaca, sont plus tard formés à travers le Rwanda.
25 ans plus tard, le Rwanda n’est plus le même pays qu’en 1994. D’une part, plus de 60% de la population est née depuis le génocide; leurs seuls souvenirs sont ceux de ce qui s’est passé après le génocide. Et la période la plus récente du Rwanda a été remarquable. Nulle part ailleurs des programmes de justice et de réconciliation n’ont été entrepris à une telle échelle, et bien qu’ils ne puissent jamais guérir toutes les blessures, les Rwandais de toutes les communautés ont travaillé ensemble pour construire une nouvelle identité nationale plus unifiée. Le projet Umuganda a été développé, où les communautés et les voisins se réunissent une fois par mois pour travailler sur un projet communautaire pour encourager l’unité.Le dernier samedi du mois, toujours de nos jours, toutes les personnes valides âgées de 18 à 65 ans doivent passer trois heures à travailler ensemble sur un projet.

Le président hutu Pasteur Bizimungu démissionne après s’être brouillé avec des membres de son parti au pouvoir dominé par les Tutsis. Le vice-président Paul Kagame est élu président par les députés et les ministres.

La même année, Kagame annonce Vision 2020, un cadre visant à réduire la pauvreté en se concentrant sur des objectifs spécifiques, dont la transformation agricole.
En savoir plus >>
Livre :The precolonial kingdom of Rwanda: a reinterpretation | J. K. RENNIE | Transafrican Journal of History



































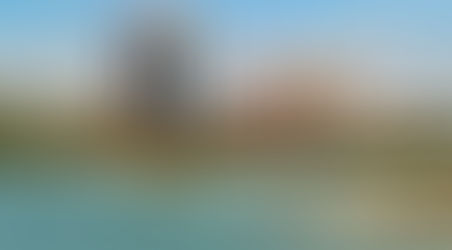






Commentaires